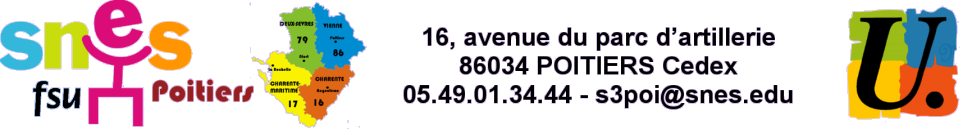Dans les établissements où les regroupements de niveaux ont été mis en place, des collègues vivent l’enfer, se sentant démuni·es face à une concentration des difficultés scolaires.

L’hétérogénéité est-elle LE problème ?
Il y a environ un an, Gabriel Attal avançait l’argument selon lequel les regroupements de niveaux permettraient de soulager les enseignant·es face à la gestion de l’hétérogénéité des classes. Cet argument était habile, car il touchait un point sensible : depuis des années, les enseignant·es signalent effectivement la difficulté de gérer des classes composées de profils très variés. Cette problématique a d’ailleurs été relayée par de nombreuses organisations syndicales, y compris la nôtre, le SNES-FSU. Toutefois, nous avons toujours associé la dénonciation de cette difficulté à la revendication d’une nécessaire réduction des effectifs dans toutes les classes.
Cependant, l’expression « difficulté à gérer l’hétérogénéité » reste trop vague. C’est bien ce que répondent les enseignant·es pris dans le quotidien quand on leur demande de se prononcer brièvement sur les obstacles rencontrés dans leur travail. Mais qu’est-ce qui est réellement difficile dans une classe où les élèves ont des niveaux d’acquis différents et des rythmes d’apprentissage variés ? Ne pas avoir le temps ni les moyens de répondre aux besoins des élèves. C’est ce qui ressort immanquablement lorsque les enseignant·es sont en situation de prendre du recul, d’interroger leur activité quotidienne et d’échanger. La gestion de la diversité pédagogique, tant dans la classe qu’en dehors, exige un temps considérable. Or ce temps est souvent réduit par une accumulation d’autres tâches administratives ou organisationnelles et évidemment le nombre croissant d’élèves dans les classes. Ainsi, c’est l’organisation même du travail qui génère cette difficulté, en comprimant les moments où l’enseignant·e peut réellement se consacrer à chaque élève.
Ce qui est également difficile, c’est de constater que, malgré tous leurs efforts, certain·es élèves ne progressent pas, ou pas suffisamment. À la fin de l’année scolaire, le constat répété que des élèves restent en marge des apprentissages est décourageant. Les élèves en difficulté, en particulier dans les classes nombreuses voire surchargées, ont des profils très divers, avec des besoins variés. Les identifier, les comprendre, et y répondre demande du temps et des ressources dont l’organisation du travail réduit d’année en année la disponibilité.
Ces éléments, bien que succincts, permettent déjà de percevoir les paradoxes que cache le projet de Gabriel Attal.
Regrouper les élèves en difficulté dans des classes homogènes à effectifs réduits : une fausse solution ?
L’idée de rassembler les élèves en difficulté scolaire, en français et en mathématiques, dans des regroupements homogènes avec des effectifs réduits peut sembler séduisante à première vue. L’objectif annoncé était double : aider ces élèves à progresser ET alléger le travail des enseignant·es. Mais cette solution repose sur une méconnaissance fondamentale de la réalité pédagogique.
Les professionnel·les de l’enseignement savent bien que l’homogénéité de la difficulté scolaire n’existe pas. Il n’y a pas un seul type d’élève en difficulté, ni même quatre ou cinq profils types. La difficulté scolaire est fondamentalement hétérogène, avec des causes multiples et diverses. Même lorsqu’on peut identifier certaines causes communes, elles s’entremêlent de manière unique pour chaque élève, en fonction de son histoire, de son environnement familial et social, et de son rapport à l’école. En d’autres termes, la réalité des élèves ne peut être réduite à de simples performances scolaires. Ils et elles ne sont pas que des cerveaux isolés, mais des individus aux vécus et aux contextes variés, lesquels influencent directement leurs apprentissages.
L’année dernière, le SNES-FSU écrivait déjà que les enseignant·es ayant des « groupes de besoins » de niveau faible ne feraient pas l’expérience d’un enseignement facilité par la réduction des effectifs, mais seraient confronté·es à une concentration de la difficulté. Les premiers retours sur la mise en place de ces groupes confirment cette prévision. Dans les établissements où des groupes « faibles » ou « moyens-faibles » ont été créés, les enseignant·es se retrouvent avec une vingtaine d’élèves, parfois moins. Mais ce qui devrait théoriquement faciliter leur travail devient au contraire un défi supplémentaire. Ces élèves, malgré leur nombre réduit, présentent des difficultés très différentes. Faire un cours homogène à une vingtaine d’élèves en difficulté ne fonctionne pas. Adapter son cours pour cinq profils différents épuisera mais ne fonctionnera pas non plus pour la plupart des élèves. Prendre en compte la multiplicité et la diversité des difficultés d’autant d’élèves, fussent-ils moins d’une vingtaine, est en réalité impossible. D’autant que la concentration des difficulté prive l’enseignant de dynamiques positives comme l’émulation et en développe des négatives : en particulier des stratégies de sauvegarde de l’estime de soi qui amènent les élèves à ne pas coopérer par exemple, en considérant que les mathématiques et eux, « ça fait deux » ou que « lire des bouquins », c’est pas leur « truc ». La majorité de la classe peine à progresser de manière satisfaisante car les difficultés sont concentrées, souvent profondes et très variées.
On retrouve là, a contrario, certains des éléments des nombreuses études relayées par le SNES-FSU et tant d’autres acteurs du monde de l’Education. Celles qui montraient que la diversité peut être un levier pour renforcer l’apprentissage collectif quand les conditions sont réunies. Travaux et recherches purement piétinés par le ministère. Mais peut-être a-t-il décidé au départ qu’il ne fallait pas réunir ces conditions, pour permettre à quelques uns de s’envoler.
Illusion de la réforme et vrais paradoxes d’une solution simpliste
Et des enseignant·es se retrouvent ainsi à devoir gérer un groupe d’élèves où la diversité des besoins est toujours présente, et même condensée et amplifiée, mais avec un encadrement et des ressources pédagogiques tout aussi limités qu’avant. Leur disponibilité pour chaque élève reste restreinte, d’autant plus que cette réforme s’accompagne, une fois de plus, de nouvelles et lourdes tâches administratives et organisationnelles qui viennent s’ajouter à celles déjà existantes. L’urgence, les délais courts, les pressions hiérarchiques ont en outre renforcé la brutalité de la mise en place du dispositif dans de nombreux établissements. La probabilité de postes non pourvus dans deux disciplines touchées par la crise de recrutement a été sous-évaluée voire niée. Nous trouvons là les ferments de la désorganisation d’établissements qui se rajoutent au non sens pédagogique expliqué plus haut. Dans les établissements où il n’a pas été possible de s’opposer ou de désamorcer la réforme, des collègues subissent la double voire la triple peine : des classes où il est plus difficile de travailler, une désorganisation accrue, des pressions pour pallier la désorganisation.
Imputer les échecs de cette approche uniquement à des difficultés d’organisation ou à une réduction insuffisante des effectifs serait une erreur. Le véritable problème réside dans la conception même de cette réforme, qui repose sur une vision erronée de la réalité scolaire. Il n’y a que dans l’imaginaire de Gabriel Attal et de celles et ceux qui sont éloignés des salles de classe que la difficulté scolaire peut être perçue comme homogène. Pour ces décideurs et décideuses, les élèves dits « faibles » représentent une altérité radicale, un ensemble uniforme que l’on peut traiter avec des solutions simplistes. En réalité, cette vision repose sur des stéréotypes qui trahissent une méconnaissance profonde des élèves.